 « Seigneur… dis seulement une parole et je serai guéri ». Nous connaissons cette phrase de l’Evangile. Nous la redisons à chaque Eucharistie, quelques instants avant de nous approcher du Corps du Christ. Cette année, cette phrase va nous aider au long de cette quarantaine, pour nous permettre d’entrer un peu plus dans cette demande adressée au Christ, Maître de nos vies, Maître et pédagogue de ce Carême.
« Seigneur… dis seulement une parole et je serai guéri ». Nous connaissons cette phrase de l’Evangile. Nous la redisons à chaque Eucharistie, quelques instants avant de nous approcher du Corps du Christ. Cette année, cette phrase va nous aider au long de cette quarantaine, pour nous permettre d’entrer un peu plus dans cette demande adressée au Christ, Maître de nos vies, Maître et pédagogue de ce Carême.
Mais, en ce jour des Cendres, il ne s’agit pas d’abord de parole, ni même de guérison, au moins en apparence. Dans un instant, les Cendres vous recouvrir notre tête ou notre front : ce sont les cendres que la Bible réserve à Job, Judith, Esther et tant d’autres, tous ceux qui font pénitence ou qui prennent le deuil. On déchire son vêtement, on se couvre de cendres et on implore la miséricorde, pour demander pardon et pour s’approcher à nouveau du Dieu trois fois saint. Ces cendres, ce sont également la poussière du livre de la Genèse, glaise primordiale qui nous rattache à la condition originelle et fragile du premier homme : Adam, pétri de la poussière, tiré de la terre et, à qui il est promis qu’il y retournera.
Ces cendres, nous allons simplement les recevoir, pour entrer tous ensemble dans ce temps si particulier du Carême. Tous ensemble, en Eglise, à un moment qu’aucun d’entre nous n’a choisi. L’Eglise nous fait donc entrer en ce jour dans le temps du désert propice à la conversion, lente marche laborieuse et ascétique vers l’homme nouveau que le Maître de nos vies veut restaurer en nous.
Je me permets de vous faire remarquer que pour faire ces cendres, il faut que le feu ait embrasé le buis que vous avez déposé. Il y a eu feu et braises, avant qu’elles ne refroidissent pour être déposé sur nos fronts. Ces cendres nous rappellent donc le feu et les braises ardentes de la foi de notre baptême, que nous avons laissé s’éteindre peu à peu. C’est donc un peu avec confusion que ce soir nous recevons la trace sur notre front de notre tiédeur, de nos lâchetés, de notre orgueil, bref de tout ce que le péché a éteint en nous. Du coup, ces 40 jours ne seront pas de trop pour qu’un vent puissant vienne souffler sur elles pour faire rejaillir le feu qui couvait encore sous la cendre. Et quel feu, puisque ce sera le feu de la Vigile pascale ! Ce soir, nous voici donc entre deux feux, deux foyers ardents : celui de notre baptême et sa réactualisation dans celui de Pâques. Entre temps, nous avons besoin d’être secoués, réveillés. Le jeûne, la prière et le partage vont nous y aider. Je ne saurais que trop vous recommander la méditation de l’Evangile de ce soir et la mise en œuvre de ce programme.
Mais en cette instant, je veux seulement insister sur ce moment si précieux dans l’année où nous décidons tous ensemble de réponse à l’appel de l’Eglise et du Christ de nous convertir. C’est le moment favorable. C’est le moment de notre salut. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Voici le vent puissant qui saura raviver les braises sous la cendres. Pour vous y aider, je vous propose une lecture toute simple, tirée du livre de l’Apocalypse.
Tu dis : « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien », et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! Alors je te donne un conseil :viens acheter chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir riche, des vêtements blancs pour te couvrir et cacher la honte de ta nudité, un remède pour te frotter les yeux afin de voir clair. Sois donc fervent et convertis-toi. (3,17-19) Voici un chemin pour ce soir : reconnaître que nous sommes pauvres, que nous sommes nus, que nous sommes aveugles.
Pauvres. Soyons simples : acceptons d’être pauvres pour être enrichi par Dieu. Le jeûne, la prière et le partage sont là pendant 40 jours pour creuser en nous la pauvreté, pour que nous soyons disponibles à Dieu, aux autres et à nous-même. Réjouissons-nous : c’est avec toute l’Eglise que nous prenons ce chemin d’appauvrissement.
Nus. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtus le Christ », chantons-nous avec Saint Paul à chaque baptême. Le Carême veut restaurer le vêtement blanc de notre baptême, la robe des noces de cette belle relation d’amitié avec Dieu. Allons-nous consentir à cette œuvre de rénovation intérieure où nous recevons notre dignité et notre beauté de la part de celui nous a créé sans nous, mais qui ne nous guérira pas sans nous ?
Aveugles. Une guérison à demander pendant ce Carême est celui de notre cécité : aveuglement devant nous-même, devant les autres ou devant Dieu. Notre regard est souvent obscurci par des filtres, un manque de réalisme, des imprudences, des fausses idées, des jugements malveillants. Demandons aujourd’hui de regarder comme Dieu regarde : avec bienveillance.
Curieusement, les cendres de ce soir ne nous enrichiront pas, ne nous vêtiront pas, ne guériront pas notre vue. Elles diront seulement à Dieu que nous nous disposons à son œuvre de guérison. Et c’est déjà cela notre Carême.
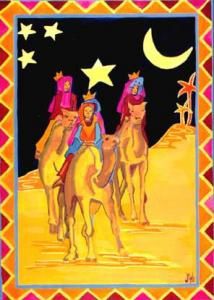 Les voici donc, ces hommes venus de loin pour se prosterner devant le Roi qui vient de naître. Quand je dis qu’ils viennent de loin, c’est un euphémisme. Ils viennent de loin physiquement, du pays du soleil levant. Ils viennent de loin si l’on en croit les cadeaux qu’ils font, l’or, la myrrhe, l’encens. Ils viennent de loin religieusement, des mages, des sages dans leur propre culture, scrutant les astres. Ils viennent de loin par rapport à la Révélation faite par Dieu au peuple hébreu. Bref, eux qui étaient loin, sont venus, ils sont devenus proches, au point de s’approcher du Messie qui vient de naître, de se prosterner devant lui.
Les voici donc, ces hommes venus de loin pour se prosterner devant le Roi qui vient de naître. Quand je dis qu’ils viennent de loin, c’est un euphémisme. Ils viennent de loin physiquement, du pays du soleil levant. Ils viennent de loin si l’on en croit les cadeaux qu’ils font, l’or, la myrrhe, l’encens. Ils viennent de loin religieusement, des mages, des sages dans leur propre culture, scrutant les astres. Ils viennent de loin par rapport à la Révélation faite par Dieu au peuple hébreu. Bref, eux qui étaient loin, sont venus, ils sont devenus proches, au point de s’approcher du Messie qui vient de naître, de se prosterner devant lui. Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire.
Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Un sondage réalisé en 2006 pour le Monde des religions donnait un chiffre intéressant : 64 % des catholiques croient aux miracles (91 % même pour les pratiquants de chaque dimanche).
Un sondage réalisé en 2006 pour le Monde des religions donnait un chiffre intéressant : 64 % des catholiques croient aux miracles (91 % même pour les pratiquants de chaque dimanche). « Nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l’oisiveté, affairés sans rien faire : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné »
« Nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l’oisiveté, affairés sans rien faire : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné »