Au commencement du Carême qui constitue un chemin d'entraînement spirituel intense, la liturgie nous propose à nouveau trois pratiques pénitentielles chères à la tradition biblique et chrétienne. La prière, l'aumône et le jeûne servent à nous préparer à mieux célébrer la Pâque et à faire ainsi l'expérience de la puissance de Dieu qui, comme nous l'entendrons au cours de la veillée pascale, triomphe du mal, lave nos fautes, redonne l'innocence aux pécheurs, la joie aux affligés, dissipe la haine, nous apporte la paix et humilie l'orgueil du monde". Le Carême est un temps de pénitence, entre le mercredi des Cendres et Pâques. En ce traditionnel message du Carême, je souhaite cette année me pencher plus particulièrement sur la valeur et le sens du jeûne. Le Carême en effet nous rappelle les quarante jours de jeûne vécus par le Seigneur dans le désert, avant le commencement de sa mission publique.
Nous lisons dans l'Evangile : Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Comme Moïse avant de recevoir les Tables de la loi, comme Elie avant de rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb, de même Jésus, en priant et en jeûnant, se prépare à sa mission, dont le début fut marqué par une dure confrontation avec le tentateur. Nous pouvons nous demander quelle valeur et quel sens peuvent avoir pour nous, chrétiens, le fait de se priver de quelque chose qui serait bon en soi et utile pour notre subsistance. L'Ecriture et toute la tradition chrétienne enseignent que le jeûne est d'un grand secours pour éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. C'est pourquoi, dans l'histoire du salut, l'invitation à jeûner revient régulièrement. Déjà dans les premières pages de l'Ecriture, le Seigneur commande à l'homme de s'abstenir de manger du fruit défendu: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangera pas, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. En commentant l'injonction divine, saint Basile observe que le jeûne a été prescrit dans le paradis terrestre, et " ce premier précepte été donné à Adam. Il conclut ainsi: Cette défense, ce tu ne mangeras pas, est une loi de jeûneet d'abstinence. Parce que tous nous sommes appesantis par le péché et ses conséquences, le jeûne nous est offert comme un moyen pour renouer notre amitié avec le Seigneur. C'est ce que fit Esdras avant le voyage du retour de l'exil en Terre promise, quand il invita le peuple réuni à jeûner pour s'humilier devant notre Dieu. Le Tout Puissant écouta leur prière et les assura de sa faveur et de sa protection. Les habitants de Ninive en firent autant quand, sensibles à l'appel de Jonas à la repentance, ils proclamèrent, comme témoignage de leur sincérité, un jeûne en disant: Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point? Là encore, Dieu vit leurs œuvres et les épargna".
"Dans le Nouveau Testament, Jésus met en lumière la raison profonde du jeûne en stigmatisant l'attitude des pharisiens qui observaient avec scrupule les prescriptions imposées par la loi, alors que leurs cœurs étaient loin de Dieu. Le vrai jeûne, redit encore en d'autre lieux le divin Maître, consiste plutôt à faire la volonté du Père céleste, lequel voit dans le secret et te récompensera. Lui-même en donne l'exemple en répondant à Satan, au terme des quarante jours passés dans le désert: Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vrai jeûne a donc pour but de manger la vraie nourriture, qui consiste à faire la volonté du Père. Si donc Adam désobéit à l'ordre du Seigneur de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le croyant entend par le jeûne se soumettre à Dieu avec humilité, en se confiant à sa bonté et à sa miséricorde".
Privation volontaire de nourriture en esprit de pénitence.
Attitude qui incite à l'indulgence et au pardon.
Transgression volontaire d'une règle ou d'un commandement divin - point de rupture entre Dieu et l'homme.
"La pratique du jeûne est très présente dans la première communauté chrétienne. Les Pères de l'Eglise aussi parlent de la force du jeûne, capable de mettre un frein au péché, de réprimer les désirs du vieil homme, et d'ouvrir dans le cœur du croyant le chemin vers Dieu. Le jeûne est en outre une pratique récurrente des saints, qui le recommandent. Saint Pierre Chrysologue écrit: Le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Donc, celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié, qu'il écoute l'homme qui demande, et qui en demandant souhaite être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie".
Privation volontaire de nourriture en esprit de pénitence.
Attitude qui incite à l'indulgence et au pardon.
Transgression volontaire d'une règle ou d'un commandement divin - point de rupture entre Dieu et l'homme.
"De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle et, dans une culture marquée par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris la valeur d'une pratique thérapeutique pour le soin du corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une thérapie pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. Dans la Constitution apostolique Pænitemini de 1966, Paul VI reconnaissait la nécessité de remettre le jeûne dans le contexte de l'appel de tout chrétien à ne plus vivre pour soi-même, mais pour Celui qui l'a aimé et s'est donné pour lui, et aussi à vivre pour ses frères. Ce Carême pourrait être l'occasion de reprendre les normes contenues dans cette Constitution apostolique, et de remettre en valeur la signification authentique et permanente de l'antique pratique pénitentielle, capable de nous aider à mortifier notre égoïsme et à ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu et du prochain, premier et suprême commandement de la Loi nouvelle et résumé de tout l'Evangile".
Le Carême est un temps de pénitence, entre le mercredi des Cendres et Pâques.
Nouvelle du salut annoncée aux hommes par Jésus.
Privation volontaire de nourriture en esprit de pénitence.
"La pratique fidèle du jeûne contribue en outre à l'unification de la personne humaine, corps et âme, en l'aidant à éviter le péché et à croître dans l'intimité du Seigneur. Saint Augustin qui connaissait bien ses inclinations négatives et les définissait comme " des nœuds tortueux et emmêlés, écrivait dans son traité sur L'utilité du jeûne: Je m'afflige certes un supplice, mais pour qu'il me pardonne. Je me châtie de moi-même pour qu'il m'aide, pour plaire à ses yeux, pour arriver à la délectation de sa douceur. Se priver de nourriture matérielle qui alimente le corps facilite la disposition intérieur à l'écoute du Christ et à se nourrir de sa parole de salut. Avec le jeûne et la prière, nous Lui permettons de venir rassasier une faim plus profonde que nous expérimentons au plus intime de nous, la faim et la soif de Dieu".
Privation volontaire de nourriture en esprit de pénitence.
Transgression volontaire d'une règle ou d'un commandement divin - point de rupture entre Dieu et l'homme.
"En même temps, le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation dans laquelle vivent tant de nos frères. Dans sa première Lettre, saint Jean met en garde: Si quelqu'un possède des richesses de ce monde et, voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Jeûner volontairement nous aide à suivre l'exemple du Bon Samaritain, qui se penche et va au secours du frère qui souffre. En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas étranger. C'est précisément pour maintenir vivante cette attitude d'accueil et d'attention à l'égard de nos frères que j'encourage les paroisses et toutes les communautés à intensifier pendant le Carême la pratique du jeûne personnel et communautaire, en cultivant aussi l'écoute de la Parole de Dieu, la prière et l'aumône. Ceci a été, dès le début, une caractéristique de la vie des communautés chrétiennes où se faisaient des collectes spéciales, tandis que les fidèles étaient invités à donner aux pauvres ce qui, grâce au jeûne, avait été mis à part. Même aujourd'hui, une telle pratique doit être redécouverte et encouragée, surtout pendant le temps liturgique du Carême".
"Il ressort clairement que le jeûne représente une pratique ascétique importante, une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements désordonnés. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d'autres biens matériels, aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine. Une hymne antique de la liturgie du Carême exhorte avec pertinence: Nous utilisons plus sobrement les paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeux, et avec plus d'attention, nous demeurons vigilants".
Le Carême est un temps de pénitence, entre le mercredi des Cendres et Pâques.
Celles et ceux qui ont suivi et qui suivent Jésus Christ.
Bienveillance de Dieu pour les hommes.
Privation volontaire de nourriture en esprit de pénitence.
Culte public qui englobe l'ensemble de la prière de l'Eglise et les célébrations sacramentelles.
Communauté locale de chrétiens, placée sous la responsabilité d'un curé mandaté par l'évêque.
"A bien y regarder, le jeûne a comme ultime finalité d'aider chacun d'entre-nous, comme l'écrivait Jean-Paul II, à faire un don total de soi à Dieu. Que le Carême soit donc mis en valeur dans toutes les familles et dans toutes les communautés chrétiennes, pour éloigner de tout ce qui distrait l'esprit et intensifier ce qui nourrit l'âme en l'ouvrant à l'amour de Dieu et du prochain. Je pense en particulier à un plus grand engagement dans la prière, la Lectio Divina, le recours au sacrement de la Réconciliation et dans la participation active à l'Eucharistie, par dessus tout à la messe dominicale".
"Avec cette disposition intérieure, nous entrons dans le climat de pénitence propre au Carême. Que la Bienheureuse Vierge Marie, Causa Nostrae Laetitiae, nous accompagne et nous soutienne dans nos efforts pour libérer notre cœur de l'esclavage du péché et pour en faire toujours plus un tabernacle vivant de Dieu. En formulant ce souhait, j'assure de ma prière tous les croyants et chaque communauté ecclésiale afin que tous suivent avec profit l'itinéraire quarésimal".
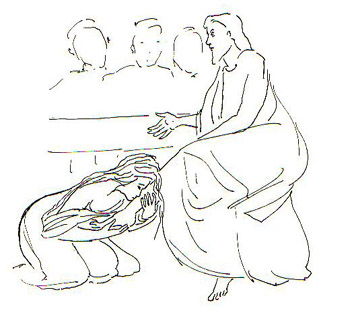 Un homme, une femme. Un hôte, une passante. Un pharisien, une pécheresse. Il avait invité Jésus à la table du festin, pensant honorer le Maître de Galilée, le Rabbi qui interprète la Loi de façon si originale. Elle vient honorer son Maître de la seule manière qu’elle peut, en lui offrant sa foi, celle de la pécheresse qui attend le pardon de Dieu.
Un homme, une femme. Un hôte, une passante. Un pharisien, une pécheresse. Il avait invité Jésus à la table du festin, pensant honorer le Maître de Galilée, le Rabbi qui interprète la Loi de façon si originale. Elle vient honorer son Maître de la seule manière qu’elle peut, en lui offrant sa foi, celle de la pécheresse qui attend le pardon de Dieu. Ce matin, alors qu'il fait encore nuit dans nos cœurs et toute l'octave de Pâques ne sera pas de trop pour dissiper les ténèbres de nos cœurs, ce matin, nous sommes ramenés au tombeau. Avec toute l'Église, avec Marie-Madeleine, avec Pierre et Jean, nous voici ramenés au tombeau. Toute la nuit et depuis trois jours, l'Église a cherché celui que son cœur aime, elle s'est levée et ne l'a pas trouvé. Elle a parcouru les rues et les places en demandant aux gardes : avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Alors dans la brise de ce matin, l'Église revient au jardin du tombeau, pour s'y remplir de la foi aimante au Christ ressuscité.
Ce matin, alors qu'il fait encore nuit dans nos cœurs et toute l'octave de Pâques ne sera pas de trop pour dissiper les ténèbres de nos cœurs, ce matin, nous sommes ramenés au tombeau. Avec toute l'Église, avec Marie-Madeleine, avec Pierre et Jean, nous voici ramenés au tombeau. Toute la nuit et depuis trois jours, l'Église a cherché celui que son cœur aime, elle s'est levée et ne l'a pas trouvé. Elle a parcouru les rues et les places en demandant aux gardes : avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Alors dans la brise de ce matin, l'Église revient au jardin du tombeau, pour s'y remplir de la foi aimante au Christ ressuscité.