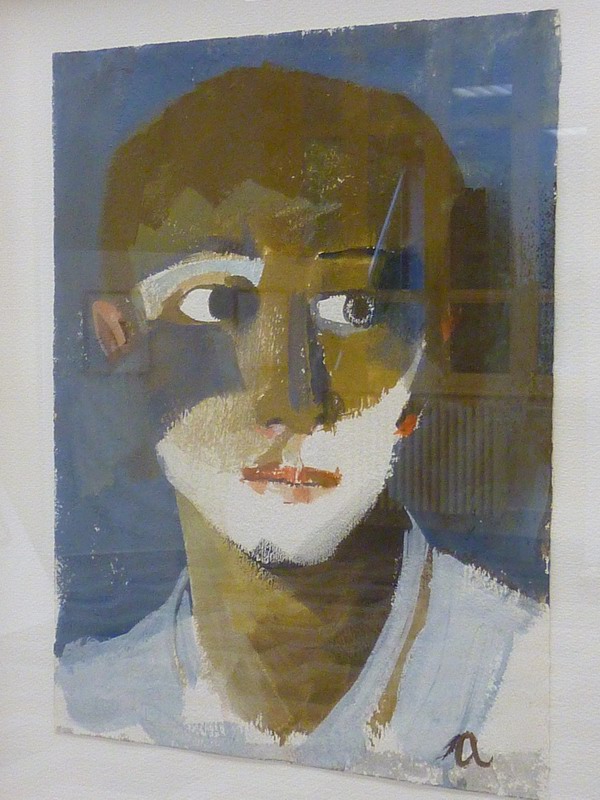 Nous connaissons bien ce passage de l’Evangile (Mc 10, 46-52). La montée de Jésus à Jérusalem passe par la ville de Jéricho. Après la dernière annonce de la Passion, dans le climat passionné qui précède son entrée triomphale à Jérusalem, le voici sortant de Jéricho, et prenant résolument la route de la Passion, la route du dépouillement, la route du salut, qui n’a rien de la gloire humaine, et encore moins d’un long fleuve tranquille. C’est le moment où ce qu’il vient apporter se dévoile, le moment où le salut vient en pleine lumière.
Nous connaissons bien ce passage de l’Evangile (Mc 10, 46-52). La montée de Jésus à Jérusalem passe par la ville de Jéricho. Après la dernière annonce de la Passion, dans le climat passionné qui précède son entrée triomphale à Jérusalem, le voici sortant de Jéricho, et prenant résolument la route de la Passion, la route du dépouillement, la route du salut, qui n’a rien de la gloire humaine, et encore moins d’un long fleuve tranquille. C’est le moment où ce qu’il vient apporter se dévoile, le moment où le salut vient en pleine lumière.
Et voici cet aveugle, suffisamment bien repéré, puisque même son nom a été gardé jusqu’à aujourd’hui. Bartimée, lui qui croupissait au bord de la route à mendier ; lui on écarte, qu’on ne voit plus ; lui qui ne voit plus. Et la rencontre est fulgurante pour cet homme. Jésus qui passe, pressé d’en découdre, pressé que son heure advienne, voici qu’il est rencontré par cet homme qui ne lui demande tout et rien. Rien de précis, mais tout : aide pitié de moi. Et il le demande, non pas au fils de Joseph, non pas au Nazaréen dont on connaît l’oeuvre de thaumaturge. Non, il le demande au fils de Dieu, le Messie Roi, celui qui vient instaurer un règne de justice et de paix. Celui là même que les foules vont acclamer à l’arrivée à Jérusalem.
Restons quelques instants avec ce sympathique Bartimée. Encore en cet instant, son apostrophe peut nous aider.
D’abord, il reconnaît son indigence et sa fragilité. A la question du Christ : Que veux-tu que je fasse pour toi, la réponse fuse, évidente pour les témoins de la scène : Que je voie ! Réponse égoïste dirons certains. Et alors. Il est aveugle. Il présente au Seigneur, le Maître de la vie, son manque, sa souffrance. Il veut vivre ! Il veut voir ! Que présentons-nous d’autre dans notre prière, sinon ces manques, ces souffrances, nos désirs de vivre
Ensuite, il confesse que seul son interlocuteur pourra le sauver. Il l’a fait pour tant d’autres, ne le fera-t-il pas pour lui ? Et quand bien même, si Jésus est le Fils de David, le Messie attendu par les prophètes, alors il réalisera ce que Dieu a promis : les aveugles verront la lumière, les sourds entendront, les boiteux marcheront, bref, tout homme verra le salut de Dieu. Le salut et non pas la santé. La foi qui ouvre le chemin de la communion avec Dieu et de la divinisation, et pas le chômage des médecins.
C’est que le miracle suppose la foi et la suscite. Il suppose la foi de celui qui demande la guérison. Il suscite la foi de ceux qui en sont témoins. Bartimée ne va-t-il pas suivre le Christ, dans sa montée à Jérusalem, dans Passion, et pourquoi pas plus vu l’affinité ?
Au début de ce miracle si déroutant, où la lumière se fait pour cet homme, où il devient un homme debout, où le mendiant se fait disciple, il y a cette phrase, cette prière instante qui est une confession de foi. « Fils de Dieu, aie pitié de moi ! » Il y a l’audace d’un priant qui crie vers son Seigneur.
Vous savez peut-être que cette prière a largement inspiré son développement dans la tradition de nos frères d’Orient. « Seigneur Jésus Christ, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur ! », ce qu’on appelle la prière du cœur. Elle tient lieu de chapelet pour tous les pèlerins des routes d’Orient. Elle est le bréviaire de ceux qui travaillent dans les champs ou dans les bibliothèques. Elle est le souffle des malades et des mourants. Elle est l’âme de tous ceux, jeunes et vieux, hommes et femmes, qui quémandent de Dieu, et de Dieu seul, le salut et la paix qu’Il veut donner à ceux qui le suivent et se confient en Lui.
« Seigneur Jésus Christ, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur ! ». C’est la prière du cœur, qui vient reconnaître ce besoin existentiel d’être sauvés. Mais nous avons besoin d’être sauvés, n’est-ce pas ? C’est la prière qui vient consentir à ce que Dieu seul nous sauvera. Mais nous ne cultivons plus l’illusion que nous nous donnerons le bonheur à nous-mêmes, n’est-ce pas ? C’est la prière qui reconnaît en Jésus plus qu’un prophète, plus qu’un thaumaturge, plus que Jonas, plus que Salomon, mais le Christ le Fils du Dieu vivant. C’est bien de lui dont nous parlons, n’est-ce pas ?
Ce même Fils de David, Fils du Dieu vivant continue de passer dans les profondeurs de notre petite Jéricho, cette ville située bien au dessous du niveau de la mer. Il passe en nous, pour monter à Jérusalem et nous mener à sa suite. Ce cri de Bartimée, cette prière du cœur est plus qu’une invitation pieuse. Elle est notre bouée, notre respiration. A une et une seule condition, celle de crier vers Lui.
 « Soyez soumis les uns aux autres… les femmes à leur mari… les hommes aimez votre femme ». Le voici donc le texte tant redouté et tant guetté. On le lit en le murmurant, on lui préféreraistpresque l’Evangile et ce dialogue entre Jésus et les apôtres. Bref, on serait tenter d’en faire l’impasse, comme un étudiant avant ses examens. .
« Soyez soumis les uns aux autres… les femmes à leur mari… les hommes aimez votre femme ». Le voici donc le texte tant redouté et tant guetté. On le lit en le murmurant, on lui préféreraistpresque l’Evangile et ce dialogue entre Jésus et les apôtres. Bref, on serait tenter d’en faire l’impasse, comme un étudiant avant ses examens. . Une fois n’est pas coutume, revenons à la première lecture. Le prophète Elie fuit la reine Jézabel dont il a prophétisé la mort. Le désert accueille sa fuite, avant qu’il n’arrive au terme d’une marche de 40 jours à l’Horeb, la montagne du Sinaï où Dieu avait parlé à Moïse. Au début même de cette marche, voici qu’il est saisi de façon assez naturelle par la fatigue, par un épuisement qui emporte tout : son énergie, son espérance, sa raison de vivre. Lui que le Seigneur a gratifié de miracle et de prodiges, le voici réduit à marcher et à souffrir. Le voilà réduit à la lassitude et à la désespérance que le fait préférer la mort. « Maintenant, Seigneur, c’en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères ! ». La vocation prophétique semble être un trop lourd fardeau. Il préfère rendre à Dieu ce qui vient de lui.
Une fois n’est pas coutume, revenons à la première lecture. Le prophète Elie fuit la reine Jézabel dont il a prophétisé la mort. Le désert accueille sa fuite, avant qu’il n’arrive au terme d’une marche de 40 jours à l’Horeb, la montagne du Sinaï où Dieu avait parlé à Moïse. Au début même de cette marche, voici qu’il est saisi de façon assez naturelle par la fatigue, par un épuisement qui emporte tout : son énergie, son espérance, sa raison de vivre. Lui que le Seigneur a gratifié de miracle et de prodiges, le voici réduit à marcher et à souffrir. Le voilà réduit à la lassitude et à la désespérance que le fait préférer la mort. « Maintenant, Seigneur, c’en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères ! ». La vocation prophétique semble être un trop lourd fardeau. Il préfère rendre à Dieu ce qui vient de lui. Au cours de cet été, nous voici au bord du lac de Galilée, avec l’Evangile selon St Jean. Pendant 5 dimanches, nous lisons et méditons ce long chapitre 6, la multiplication des pains au bord du lac et le discours du pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm.
Au cours de cet été, nous voici au bord du lac de Galilée, avec l’Evangile selon St Jean. Pendant 5 dimanches, nous lisons et méditons ce long chapitre 6, la multiplication des pains au bord du lac et le discours du pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Ce dimanche, comme tous les autres dimanches de l’année, et même tous les jours, ces paroles de Jésus vont à nouveau être prononcées ici. Quel corps et quel sang ? L’Evangile précise et nous allons également l’entendre : Corps livré pour nous, sang répandu pour la multitude. Qu’est-ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, alors que nous fêtons le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Ce dimanche, comme tous les autres dimanches de l’année, et même tous les jours, ces paroles de Jésus vont à nouveau être prononcées ici. Quel corps et quel sang ? L’Evangile précise et nous allons également l’entendre : Corps livré pour nous, sang répandu pour la multitude. Qu’est-ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, alors que nous fêtons le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ.